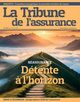Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1245 à 1245-17 du Code civil démontre, arrêt après arrêt, que son usage dans un contentieux est souvent plus subtil et complexe que l’on ne peut se l’imaginer en engageant un procès sur ce fondement.
Rappelons que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est inscrit au sein du chapitre du Code civil relatif à « la responsabilité extracontractuelle », alors qu’il s’agit avant tout d’un régime spécial de responsabilité issu de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 que le législateur français a mis tant de mauvaise volonté à transposer en 1998 qu’il faudra s’y reprendre par deux fois, via les lois du 9 décembre 2004 et du 5 avril 2006.
L’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 24 avril 2024 (n°23-12.565) rappelle ainsi avec un sens du détail notable que (point 5) : « Après avoir retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au vu des constatations de l’expert, que chaque implant, composé de pièces mobiles, avait vocation à s’user et était susceptible de casser, que la prothèse de M. Y présentait une "rupture en fatigue", sans anomalies métallurgiques macroscopiques sur la zone de fracture, qu’aucun élément ne venait mettre en avant une fragilité inappropriée du matériel d’ostéosynthèse ou sa défectuosité, que des facteurs cumulatifs avaient favorisé la rupture d’implant tenant notamment à la surcharge pondérale du patient et à une configuration physiologique spécifique et que M. Y n’établissait pas que sa prothèse ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle n’était pas défectueuse. »
C’est donc, sous...