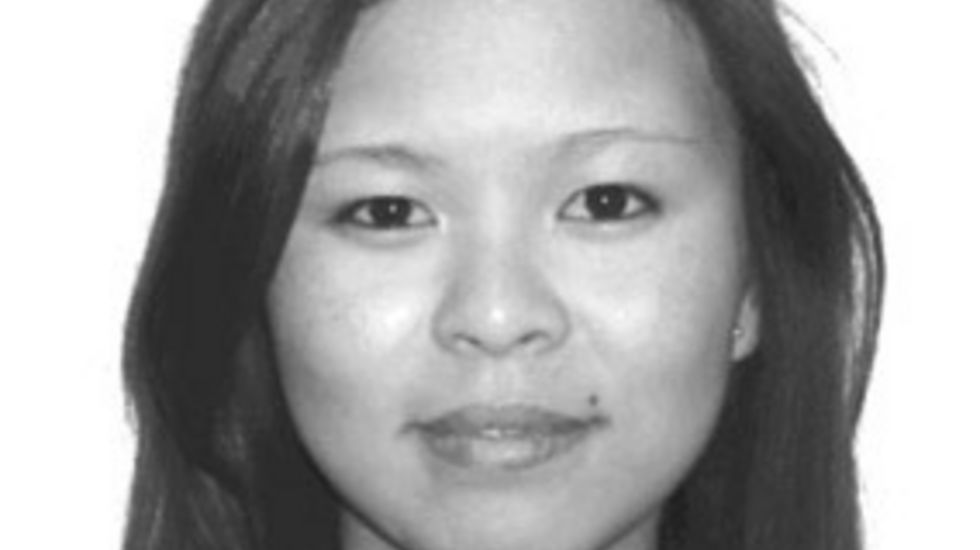La réinsertion socioprofessionnelle des victimes de dommages corporels dans une approche dite globale et personnalisée de case management peine à se développer en France. Et ce, malgré l'impulsion des pouvoirs publics.
Littéralement, "case management" signifie "gestion de cas". Cependant cette traduction brute ne reflète pas l'état d'esprit du concept. En effet, derrière le case management se cache le souci d'offrir à un individu une approche personnalisée et globale, réunissant tous les services et champs de compétences en vue de satisfaire à ses besoins. L'Association australienne du case management (CMSA) le définit d'ailleurs comme « un process collaboratif d'évaluation, de planification, d'accompagnement (et d'échanges) vers des alternatives et services répondant aux besoins d'assistance d'un individu, via la communication, la mise à disposition de ressources générant des résultats rentables ». Le case management constitue l'accompagnement de la victime dans son projet de vie personnel par un ensemble de professionnels qui coordonnent leurs services en vue de sa réinsertion socioprofessionnelle. Il s'agit de l'ensemble des intervenants qui contribuent à la réalisation du projet de vie de la victime :
- le corps médical qui travaille à sa rééducation physique et psychique ;
- les professionnels qui l'accompagnent dans l'élaboration, le financement et la mise en place de son projet de vie tant social que professionnel : organismes sociaux, maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), assureurs, avocats, magistrats, médecins experts, employeurs, ergothérapeutes, etc. ;
- les prestataires qui mettent en œuvre les services à la personne : auxiliaires de vie, femmes de ménage, architectes, etc. ;
- et bien entendu, sa famille et ses proches qui la soutiennent quotidiennement.
Le case management prend en compte une approche tridimensionnelle dite "bio-psychosociale" de la personne :
- sur le plan biologique (capacités physiques et cognitives) ;
- son état psychologique, influant nécessairement sur sa capacité et volonté à concrétiser son projet de vie ;
- et son environnement social et professionnel, lequel peut être source de pression ou, au contraire, de motivation.
Il part du postulat que l'évolution d'un patient n'est pas déterminée uniquement par ses facteurs biologiques (modèle biomédical), mais également par sa vie en communauté qui influe sur son état psychologique.