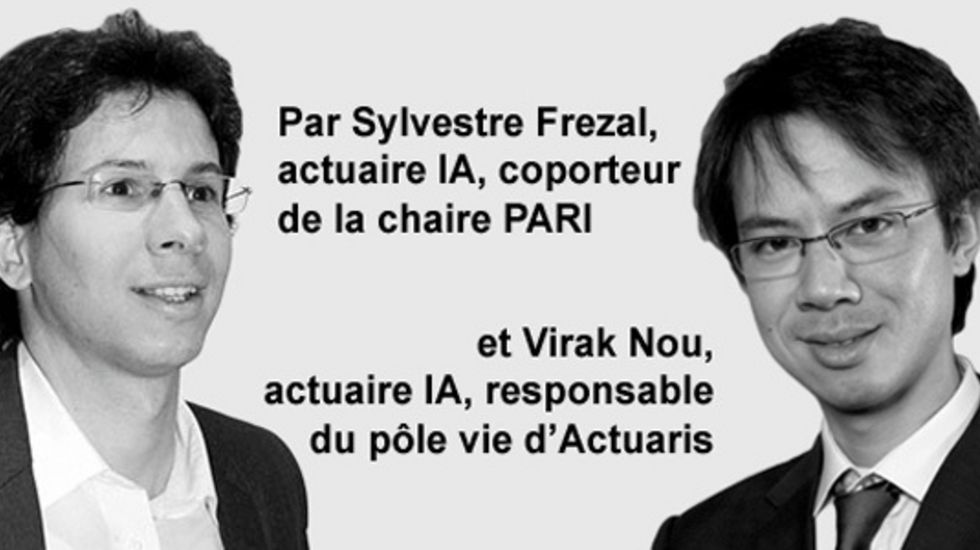Solvabilité II est un moyen au service d’une double ambition : quantifier les risques pour, d’une part, améliorer le pilotage des entreprises et, d’autre part, optimiser l’allocation du capital au niveau macroéconomique. Ces ambitions sont-elles atteintes ? Non. Que faire ?
Virak Nou, actuaire IA, responsable du pôle vie d'Actuaris
Un modèle ou un chiffre est une représentation de la réalité. Jamais parfaite, parfois utile. Pour pouvoir utiliser à bon escient ses éclairages, il est nécessaire de connaître ses limites, ses conventions, ses défauts. De ce point de vue, Solvabilité I était maîtrisable et maîtrisé. Et pour cause : une vingtaine de pages suffisait au Code des assurances pour fixer tous les paramètres quantitatifs (calcul des provisions, de la marge, de son exigence, contraintes de dispersion, etc.). Avec Solvabilité II, les spécifications techniques publiées par la Commission dépassent les 400 pages… et laissent ouvertes d’innombrables options : la documentation des modèles, pour les groupes les plus grands ou les organismes les plus complexes, représente de l’ordre de 10 à 20 000 pages, soit une Encyclopædia Universalis ! Quel dirigeant pourrait la maîtriser et parvenir à piloter à l’aide d’un tel outil en en connaissant les travers ?
Au-delà, Solvabilité II est, en assurance vie du moins, un mikado de choix se voulant réalistes (les « management rules » par exemple) et d’artefacts mathématiques dénués de lien avec le réel (le « risque neutre » par exemple). C’est un peu comme si on avait enchaîné deux maillons, l’un résistant à une force intense, mais pas longtemps, et l’autre à une force durable, mais faible, sans réaliser que la chaîne qui en résulte ne cumule pas les qualités, mais les défauts. En assurance vie, les conséquences de cette imbrication sont des résultats qui ne sont ni mathématiquement corrects, ni opérationnellement interprétables.